 Description
Description
Le Département d'Astronomie fondamentale (DANOF) de l'Observatoire de Paris comprend l'Unité de Recherche Associée 1125/CNRS "Systèmes de référence spatio-temporels" ainsi qu'une équipe de recherche en histoire de l'astronomie ancienne rattachée à l'UPR 21 du CNRS. Les liens entre cette équipe et l'URA 1125, et sa présence au sein du DANOF, s'expliquent par le fait que pendant longtemps astronomie et astronomie fondamentale se sont confondues, en particulier à l'Observatoire de Paris.
Deux services scientifiques existent au sein du DANOF. L'un, de caractère national, le Laboratoire Primaire du Temps et des Fréquences, LPTF, est responsable de l'échelle de temps légal français et constitue, sous l'égide du Bureau National de Métrologie, BNM, le laboratoire de références primaires pour l'unité de temps, la seconde, et pour les échelles de temps. L'autre, de caractère international est le Bureau Central du Service International de la Rotation Terrestre, BC/IERS, responsable de la synthèse mondiale des déterminations de l'orientation de la Terre et des systèmes de référence associés.
 Activité scientifique
Activité scientifique
L'activité scientifique du Département d'Astronomie Fondamentale couvre les domaines classiques de la définition des systèmes de référence, de la détermination du temps et des mouvements du pôle terrestre, l'étude des positions d'étoiles, de planètes et du Soleil... Ces recherches, de caractère théorique et appliqué, concernent aussi bien l'étude de la rotation de la Terre et de ses relations avec les phénomènes géophysiques, que la contribution à l'établissement de référentiels terrestres, célestes, dynamique ou cinématique, ou encore la métrologie du temps et des fréquences, notamment par la mise en œuvre de la technique du pompage optique sur jet de césium. Ces recherches ont un caractère pluridisciplinaire qui s'étend de la mécanique céleste à la physique de l'infrarouge, aux mathématiques appliquées, à la géodésie, à la géodynamique. Elles sont complétées par des recherche de nature historique.Les travaux du groupe d'histoire de l'astronomie ancienne portent principalement sur des traductions critiques d'ouvrages fondamentaux d'astronomie et sur l'exploitation du fonds d'archives anciennes et modernes.
Le domaine scientifique de ce Département est un domaine traditionnellement fort en France. Il s'est entièrement renouvelé ces dix dernières années du fait de l'amélioration spectaculaire apportée par les nouvelles techniques telles que la télémétrie laser et l'interférométrie à très longue base (VLBI) pour la réalisation des repères d'espace et des nouveaux étalons atomiques de fréquence pour la réalisation de la seconde et des échelles de temps.
Par ailleurs, les taches de service au sein du DANOF sont particulièrement lourdes aussi bien au LPTF qu'au BC/IERS. Elles s'appuient sur les recherches décrites précédemment qui sont généralement développées en coopération avec d'autres grands établissements français ou étrangers, publics ou privés.
 Description des équipes et de leursactivités
Description des équipes et de leursactivités
 L'équipe "Laboratoire Primaire du Temps et des Fréquences" dont le responsable est M. Granveaud, participe aux programmes scientifiques définis dans des cadres nationaux (référence de temps, de fréquence, pour différentes applications, en particulier astronomiques...). Ses travaux se situent dans le cadre de la métrologie française définie et subventionnée par le Bureau National de Métrologie (BNM).
L'équipe "Laboratoire Primaire du Temps et des Fréquences" dont le responsable est M. Granveaud, participe aux programmes scientifiques définis dans des cadres nationaux (référence de temps, de fréquence, pour différentes applications, en particulier astronomiques...). Ses travaux se situent dans le cadre de la métrologie française définie et subventionnée par le Bureau National de Métrologie (BNM).Dans un cadre international, le LPTF assure la participation mensuelle des horloges françaises à la référence mondiale du Temps Atomique International (TAI). En réalisant un étalon atomique à jet de césium, il répond à la recommandation du Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde. Il participe aux programmes de comparaison de temps par techniques spatiales : GPS, MITREX (liaisons à deux voies). Il contribue également à l'amélioration d'une autre grandeur fondamentale, le mètre. Enfin, il participe au programme français d'études des pulsars millisecondes.
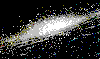 L'équipe "Systèmes de référence pour la rotation terrestre", constitue le Bureau Central (BC) du Service international de la rotation terrestre (IERS) dont la direction est confiée à M. Feissel dans le cadre d'un consortium entre l'Observatoire de Paris, l'Institut Géographique National et le Bureau des Longitudes. Le Service et son Bureau Central ont été créés en 1988 par l'Union Astronomique Internationale et l'Union Géodésique et Géophysique Internationale pour déterminer la rotation terrestre et définir les systèmes de référence terrestre et céleste associés, à partir des méthodes d'observation de précision centimétrique : radio interférométrie à longue ligne de base (VLBI), télémétrie par laser sur la Lune et sur satellites artificiels, Global Positioning System (GPS).
L'équipe "Systèmes de référence pour la rotation terrestre", constitue le Bureau Central (BC) du Service international de la rotation terrestre (IERS) dont la direction est confiée à M. Feissel dans le cadre d'un consortium entre l'Observatoire de Paris, l'Institut Géographique National et le Bureau des Longitudes. Le Service et son Bureau Central ont été créés en 1988 par l'Union Astronomique Internationale et l'Union Géodésique et Géophysique Internationale pour déterminer la rotation terrestre et définir les systèmes de référence terrestre et céleste associés, à partir des méthodes d'observation de précision centimétrique : radio interférométrie à longue ligne de base (VLBI), télémétrie par laser sur la Lune et sur satellites artificiels, Global Positioning System (GPS).
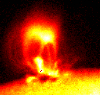 L'équipe "Astrolabes et systèmes de référence" dont le responsable est F. Chollet, collabore aux recherches du Groupe de travail "Astrolabes" de la Commission 8 de l'UAI (présidé par F. Chollet), relatives aux raccordements de systèmes de référence distincts tels que ceux liés au Soleil et aux planètes (système dynamique), aux étoiles fondamentales (système stellaire galactique) et aux radioétoiles, ainsi qu'aux problèmes de positionnement dans ces systèmes. Dans le cadre du Groupe de Travail de la commission 19 de l'UAI "Earth rotation in the Hipparcos Reference Frame", une réduction nouvelle de la longue série d'observations à l'astrolabe de Paris (1956-1983) est en préparation. Enfin en collaboration avec le Groupe Astrolabe solaire de l'Observatoire de la Côte d'Azur/Département CERGA, des travaux instrumentaux sont en cours, plus particulièrement dans le domaine de l'automatisation de l'astrolabe et de la numérisation, en temps réel, des données d'observation (caméra CCD).
L'équipe "Astrolabes et systèmes de référence" dont le responsable est F. Chollet, collabore aux recherches du Groupe de travail "Astrolabes" de la Commission 8 de l'UAI (présidé par F. Chollet), relatives aux raccordements de systèmes de référence distincts tels que ceux liés au Soleil et aux planètes (système dynamique), aux étoiles fondamentales (système stellaire galactique) et aux radioétoiles, ainsi qu'aux problèmes de positionnement dans ces systèmes. Dans le cadre du Groupe de Travail de la commission 19 de l'UAI "Earth rotation in the Hipparcos Reference Frame", une réduction nouvelle de la longue série d'observations à l'astrolabe de Paris (1956-1983) est en préparation. Enfin en collaboration avec le Groupe Astrolabe solaire de l'Observatoire de la Côte d'Azur/Département CERGA, des travaux instrumentaux sont en cours, plus particulièrement dans le domaine de l'automatisation de l'astrolabe et de la numérisation, en temps réel, des données d'observation (caméra CCD).
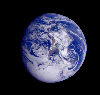 Les travaux de recherche de l'équipe "Théorie de la rotation de la Terre" (responsable N. Capitaine) s'attachent aux aspects cinématiques, dynamiques et géophysiques de cette rotation avec une participation active à plusieurs groupes de travail de l'UAI concernant à la fois les "Systèmes de Référence", la "Nutation céleste" et "L'utilisation du catalogue Hipparcos". Les activités de recherche comprennent d'une part la modélisation des paramètres de la nutation céleste et de la vitesse angulaire de rotation de la Terre avec une précision meilleure que la milliseconde de degré et d'autre part, l'analyse de longues séries d'observations de la rotation de la Terre pour améliorer les constantes d'intégration intervenant dans cette modélisation.
Les travaux de recherche de l'équipe "Théorie de la rotation de la Terre" (responsable N. Capitaine) s'attachent aux aspects cinématiques, dynamiques et géophysiques de cette rotation avec une participation active à plusieurs groupes de travail de l'UAI concernant à la fois les "Systèmes de Référence", la "Nutation céleste" et "L'utilisation du catalogue Hipparcos". Les activités de recherche comprennent d'une part la modélisation des paramètres de la nutation céleste et de la vitesse angulaire de rotation de la Terre avec une précision meilleure que la milliseconde de degré et d'autre part, l'analyse de longues séries d'observations de la rotation de la Terre pour améliorer les constantes d'intégration intervenant dans cette modélisation.La responsabilité du DEA de l'Observatoire de Paris (co-habilitation ENSG et Université Paris 6), intitulé "Astronomie Fondamentale, Mécanique Céleste et Géodésie" est, par ailleurs, confiée à un chercheur de l'URA1125/DANOF (N. Capitaine).
 L'équipe d'histoire de l'astronomie ancienne, qui a pour responsable J.-P. Verdet, se consacre essentiellement à des traductions commentées et annotées de textes astronomiques qu'ils soient latins, grecs ou arabes.
L'équipe d'histoire de l'astronomie ancienne, qui a pour responsable J.-P. Verdet, se consacre essentiellement à des traductions commentées et annotées de textes astronomiques qu'ils soient latins, grecs ou arabes.La traduction de l'ouvrage principal de Copernic, le De revolutionibus orbium coelestium paru en 1543, pourra enfin être publiée par Les Belles Lettres et les Editions du C.N.R.S. Ce livre sera suivi d'un autre volume contenant des écrits mineurs de Copernic, en particulier écrits astronomiques et monétaires, sous la direction de Henri Hugonnard-Roche. Deux autres volumes sont encore prévus et comprendront les deux textes de G.J. Rheticus (Narratio prima et Narratio secunda) tandis que le dernier donnera la première édition traduction des Tabulae Prutenicae de Erasme Rheinhold.
Parallèlement à ce travail de traduction de Copernic, l'équipe a entrepris l'édition critique du texte latin et la traduction de l'Epitome in Almagestum de Jean Regiomontanus. Ce travail de longue haleine a fait l'objet sur le campus de Paris de séminaires d'histoire de l'astronomie.

Derniére date de mise à jour 24/05/95
 Information DANOF -
Alain Hayot - danof@mesiob.obspm.fr
Information DANOF -
Alain Hayot - danof@mesiob.obspm.fr