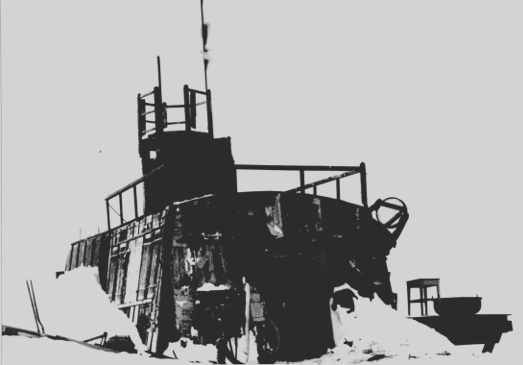 Observatoire au sommet du Mont Blanc; remarquer
la lunette et le sidérostat polaire à droite de la
photographie.
Observatoire au sommet du Mont Blanc; remarquer
la lunette et le sidérostat polaire à droite de la
photographie.


 http://www.obspm.fr/histoire/montblanc/montblanc.html (Einblicke ins Internet, 10/1995)
http://www.obspm.fr/histoire/montblanc/montblanc.html (Einblicke ins Internet, 10/1995)JANSSEN recherchait le site le plus élevé et le plus pur possible pour éliminer la composante tellurique dans le spectre solaire provenant de l'absorption atmosphérique.
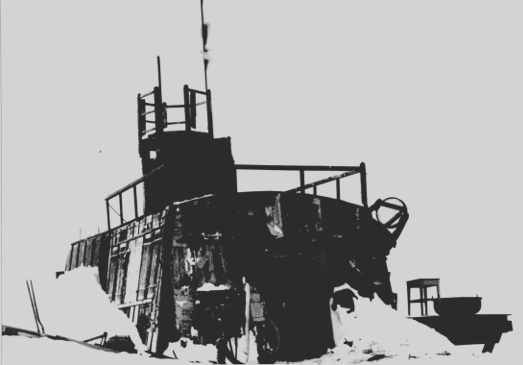 Observatoire au sommet du Mont Blanc; remarquer
la lunette et le sidérostat polaire à droite de la
photographie.
Observatoire au sommet du Mont Blanc; remarquer
la lunette et le sidérostat polaire à droite de la
photographie.
Ces thèmes tirent pleinement parti des qualités du site: altitude, pureté du ciel et horizon exceptionnels, pression atmosphérique moitié de celle du niveau de la mer, illumination nocturne réduite (pas de poussière); écoulement laminaire des masses d'air par bonnes conditions météorologiques (pas de turbulence, donc absence de scintillation).
La station, posée au sommet du Mont Blanc sur la glace, fut ressentie comme concurrente du laboratoire VALLOT fondé quelques années auparavant 450 mètres plus bas: quelle erreur! VALLOT était lui mêumflex;me tout sauf astronome, et l'expérience du Col de Sencours sous le Pic du Midi de Bigorre venait de démontrer clairement pour l'astronomie la supériorité des sommets sur le flanc des montagnes.
L'Observatoire du Mont Blanc fut aussi injustement critiqué car il ne put êumflex;tre exploité que pendant 10 ans, à un moment où l'on recherchait la perennité. Au contraire, l'opération "Mont Blanc" semblait en avance sur son temps. Visionnaire, JANSSEN avait compris quels étaient les enjeux résultant d'observations astronomiques à une altitude aussi exceptionnelle, dans le contexte des préoccupations scientifiques de l'époque (naissance de la spectroscopie et de l'astrophysique), et ceci quelle que fut la longévité de l'édifice, très difficilement prévisible. Les grands équipements actuels (télescopes géants au sol, sondes spatiales, satellites) n'accomplissent-ils pas leur mission en dix ans ?
Et pour finir, citons JANSSEN: "Quelle station que cette cime ! Quels levers et quels couchers, quelles nuits !".
ATTENTION: ces images sont la PROPRIETE DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS et ne peuvent êumflex;tre utilisées ou reproduites sans son autorisation explicite.
Pour agrandir chaque image, CLIQUEZ dessus.
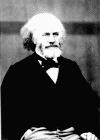 Portrait de JANSSEN
(1824-1907), astronome, membre de l'Institut, fondateur de l'Observatoire de
Meudon (1876).
Portrait de JANSSEN
(1824-1907), astronome, membre de l'Institut, fondateur de l'Observatoire de
Meudon (1876).
 JANSSEN en observation
au télescope de 1 m de Meudon.
JANSSEN en observation
au télescope de 1 m de Meudon.
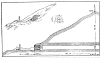 Sondages infructueux
effectués
12 m sous le sommet du Mont Blanc (2 galeries de 23 m de long creusées
dans la glace) à la recherche du rocher.
Sondages infructueux
effectués
12 m sous le sommet du Mont Blanc (2 galeries de 23 m de long creusées
dans la glace) à la recherche du rocher.
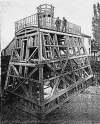 Charpente de
l'Observatoire construit à Meudon avant son démontage et transport
pour le sommet du Mont Blanc. La construction, en bois, comportait deux
niveaux dont l'un était destiné à êumflex;tre enfoui
sous la neige, de façon à résister aux vents violents
fréquents à 4800 m d'altitude.
Charpente de
l'Observatoire construit à Meudon avant son démontage et transport
pour le sommet du Mont Blanc. La construction, en bois, comportait deux
niveaux dont l'un était destiné à êumflex;tre enfoui
sous la neige, de façon à résister aux vents violents
fréquents à 4800 m d'altitude.
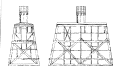 Vues de profil et
de face de l'ossature de l'Observatoire.
Vues de profil et
de face de l'ossature de l'Observatoire.
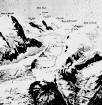 Itinéraires
d'accès pratiqués au Mont Blanc il y a 100 ans. On partait de
Chamonix à dos de mulet, jusqu'à l'auberge de Pierre Pointue;
on faisait ensuite halte vers 2500 m à la "Pierre à
l'échelle", endroit où les guides laissaient des
échelles pour faciliter le franchissement des crevasses du glacier,
généralement très tourmenté
jusqu'au refuge des Grands Mulets (3050 m).
De là, on gagnait le Grand Plateau (4000 m) par de grandes pentes
sous les séracs du Dôumflex;me du Goûumblex;ter. On
continuait alors vers le Mont Blanc soit par le Corridor, le Col de la Brenva
et les Rochers Rouges (itinéraire suivi par JANSSEN en 1893 et 1895
en raison de l'abri qu'il y avait érigé et du moindre danger
pour le passage du traineau, mais délaissé aujourd'hui),
soit par le Col du Dôumflex;me,
le laboratoire VALLOT et
l'Arêumflex;te des Bosses (voie normale actuelle de Printemps et
empruntée par JANSSEN en 1890).
Itinéraires
d'accès pratiqués au Mont Blanc il y a 100 ans. On partait de
Chamonix à dos de mulet, jusqu'à l'auberge de Pierre Pointue;
on faisait ensuite halte vers 2500 m à la "Pierre à
l'échelle", endroit où les guides laissaient des
échelles pour faciliter le franchissement des crevasses du glacier,
généralement très tourmenté
jusqu'au refuge des Grands Mulets (3050 m).
De là, on gagnait le Grand Plateau (4000 m) par de grandes pentes
sous les séracs du Dôumflex;me du Goûumblex;ter. On
continuait alors vers le Mont Blanc soit par le Corridor, le Col de la Brenva
et les Rochers Rouges (itinéraire suivi par JANSSEN en 1893 et 1895
en raison de l'abri qu'il y avait érigé et du moindre danger
pour le passage du traineau, mais délaissé aujourd'hui),
soit par le Col du Dôumflex;me,
le laboratoire VALLOT et
l'Arêumflex;te des Bosses (voie normale actuelle de Printemps et
empruntée par JANSSEN en 1890).
 JANSSEN en route pour
les Grands Mulets (3050 m) sur la chaise échelle qu'il avait
conçue pour se faire transporter.
JANSSEN en route pour
les Grands Mulets (3050 m) sur la chaise échelle qu'il avait
conçue pour se faire transporter.
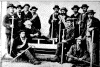 JANSSEN et ses douze
vaillants guides de Chamonix. Son guide chef s'appelait Frédéric
PAYOT.
JANSSEN et ses douze
vaillants guides de Chamonix. Son guide chef s'appelait Frédéric
PAYOT.
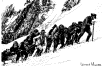 JANSSEN sur son traineau
tiré par ses guides dans les raides
pentes menant au Grand Plateau (4000 m) et à la cabane VALLOT.
JANSSEN sur son traineau
tiré par ses guides dans les raides
pentes menant au Grand Plateau (4000 m) et à la cabane VALLOT.
 Halte au chalet
laboratoire VALLOT en 1890 sur la route du Mont Blanc (4350 m).
Halte au chalet
laboratoire VALLOT en 1890 sur la route du Mont Blanc (4350 m).
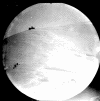 L'Observatoire
JANSSEN au sommet du Mont Blanc vu à la lunette.
L'Observatoire
JANSSEN au sommet du Mont Blanc vu à la lunette.
 Cordée et
Observatoire au sommet du Mont Blanc (4807 m).
Cordée et
Observatoire au sommet du Mont Blanc (4807 m).
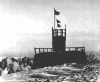 Observatoire JANSSEN
au sommet du Mont Blanc. Ce curieux "paquebot des glaces" est surmonté
d'une tourelle d'observation météorologique.
Observatoire JANSSEN
au sommet du Mont Blanc. Ce curieux "paquebot des glaces" est surmonté
d'une tourelle d'observation météorologique.
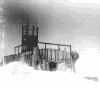 Observatoire JANSSEN
au sommet du Mont Blanc; remarquer le tube de la lunette qui dépasse
à droite du bâumflex;timent.
Observatoire JANSSEN
au sommet du Mont Blanc; remarquer le tube de la lunette qui dépasse
à droite du bâumflex;timent.
 Observatoire JANSSEN
au sommet du Mont Blanc. Le niveau inférieur, enfoui dans la neige,
reposait sur des vérins permettant de corriger son assise.
Observatoire JANSSEN
au sommet du Mont Blanc. Le niveau inférieur, enfoui dans la neige,
reposait sur des vérins permettant de corriger son assise.
 L'une des
innombrables cartes postales éditées à
l'époque de l'Observatoire.
L'une des
innombrables cartes postales éditées à
l'époque de l'Observatoire.
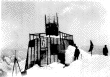 Autre
carte postale éditée à
l'époque de l'Observatoire, dont le succès fut retentissant.
Autre
carte postale éditée à
l'époque de l'Observatoire, dont le succès fut retentissant.
 Givre a l'Observatoire
JANSSEN. A gauche, le tube de la grande lunette de 33 cm.
Givre a l'Observatoire
JANSSEN. A gauche, le tube de la grande lunette de 33 cm.
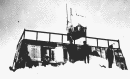 Givre a l'Observatoire
JANSSEN.
Givre a l'Observatoire
JANSSEN.
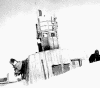 La grande lunette est
parallèle à l'axe du monde et alimentée par un
sidérostat polaire. De ce fait, l'observateur peut se tenir dans
une pièce close à l'abri du froid.
La grande lunette est
parallèle à l'axe du monde et alimentée par un
sidérostat polaire. De ce fait, l'observateur peut se tenir dans
une pièce close à l'abri du froid.
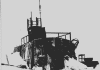 Vue du
sidérostat polaire qui servait à renvoyer la lumière
céleste dans la direction fixe et parallèle à l'axe des
pôumflex;les de la grande lunette (qui pivotait seulement autour de son
axe avec un
mécanisme d'horlogerie).
Vue du
sidérostat polaire qui servait à renvoyer la lumière
céleste dans la direction fixe et parallèle à l'axe des
pôumflex;les de la grande lunette (qui pivotait seulement autour de son
axe avec un
mécanisme d'horlogerie).
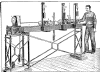 Météorographe à longue marche de l'Observatoire
JANSSEN.
Météorographe à longue marche de l'Observatoire
JANSSEN.
 Mouvement de
l'Observatoire JANSSEN à la surface de la calotte sommitale glaciaire
du Mont Blanc entre 1893 et 1906.
Mouvement de
l'Observatoire JANSSEN à la surface de la calotte sommitale glaciaire
du Mont Blanc entre 1893 et 1906.
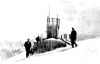 L'Observatoire
s'enfonce dans le glacier...
L'Observatoire
s'enfonce dans le glacier...
 L'Observatoire
JANSSEN s'enfonce lentement mais inexorablement dans les glaces et
devra êumflex;tre abandonné en 1909. Seule émerge
sa tourelle.
L'Observatoire
JANSSEN s'enfonce lentement mais inexorablement dans les glaces et
devra êumflex;tre abandonné en 1909. Seule émerge
sa tourelle.
 Home Page
Home Page